Le 28 mars 2018, après la mort de Mireille Knoll, j’ai marché contre l’antisémitisme à l’initiative du Crif. S’y trouvaient des forces et personnes aux antipodes de mes idées, y compris Marine Le Pen. Personne ne m’en a fait le reproche.
Je l’ai fait à nouveau le 19 février : je me suis retrouvé place de la République avec tout l’arc politique français, dont des personnalités évidemment très éloignées, pour dire de nouveau non à l’antisémitisme. Personne ne m’en a fait le reproche.
Le 14 octobre 2019, j’ai tenu un meeting en solidarité avec les Kurdes du Rojava, à l’initiative de Jean-Christophe Lagarde, où j’ai côtoyé des responsables politiques ou associatifs tout aussi éloignés de moi, tels Bruno Retailleau ou Bernard-Henri Lévy. Personne ne m’en a fait le reproche.
Le 10 novembre 2019, je marcherai contre la haine envers les musulmans, avec des personnalités proches et d’autres éloignées de mes combats politiques. Je marcherai sans hésiter car comme dans les autres cas, la cause est noble et la situation appelle à une réaction forte. Mais cette fois, on me le reproche.
Ces reproches viennent y compris de mon «camp», voilà pourquoi je tiens à convaincre.
On me dit que j’aurais changé. C’est surtout la période qui a changé. Longtemps, j’ai refusé le terme «islamophobie». Il présentait le risque de subordonner le combat antiraciste au prisme de l’appartenance religieuse. J’y voyais le danger de transformer toute critique d’une religion, un droit légitime, en un soi-disant racisme. Mais à mes yeux, le propre d’un militant politique est de ne pas rester figé dans une négation du réel et d’être à l’écoute de ceux qui sont opprimés. Des digues ont sauté en grand : c’est bien au nom de leur religion que des millions de nos concitoyens sont aujourd’hui discriminés. Ils le disent, dans la dernière enquête menée pour la Dilcrah et la fondation Jean-Jaurès : plus de quatre musulmans sur dix ont fait l’objet d’au moins une forme de discrimination liée à leur religion.
Depuis plusieurs années, les Français musulmans subissent en effet une campagne de discriminations allant crescendo ; ils sont désignés sans cesse comme en dehors de la sphère de la République, comme des ennemis intérieurs.
La comparaison assumée entre des musulmans et les nazis, l’humiliation et l’exclusion publique d’une mère portant un voile au conseil régional de Bourgogne, la proposition de délation à peine masquée vantée par le président de la République puis concrétisée par un ministre appelant à signaler les petits garçons refusant la main d’une petite fille… Tous ces faits n’ont eu lieu qu’en l’espace de deux mois depuis la rentrée. Jusqu’à cet attentat devant une mosquée, par haine assumée de ses croyants. Tous les militants du camp progressiste, tous les républicains convaincus devraient s’alarmer de cette avalanche de haine. Au lieu de cela, silence radio… Des compatriotes sont insultés, publiquement dénigrés, maintenant ciblés physiquement et ni le président de la République ni même un ministre n’ont daigné se déplacer devant la mosquée à Bayonne pour exprimer la solidarité de la Nation…
Aujourd’hui, comme d’autres par le passé, des gens sont discriminés en raison de leur appartenance religieuse. L’historien Gérard Noiriel l’a bien analysé dans son livre comparatif entre Drumont et Zemmour. Voilà le danger prioritaire.
Le risque de dérive communautariste, c’est-à-dire la capacité d’une communauté de subordonner les lois de notre République aux lois d’une religion ou de ses intérêts particuliers, n’a pas aujourd’hui de réalité de masse. Et si danger communautariste il y a, peut-être faut-il plutôt regarder vers certains quartiers de Neuilly ou du XVIe arrondissement de Paris, où les «ghettos de riches», si bien analysés par les Pinçon-Charlot, évoluent dans une endogamie assumée, tout en imposant au pays une politique conforme à leurs intérêts de classe.
Les politiques identitaires, qui ne sont malheureusement plus l’exclusivité du Rassemblement national, et les inégalités du libéralisme sauvage portés par le gouvernement français sont un danger bien plus grand pour saper nos fondements républicains. Si risque de division il y a, il vient bien plus de cette haine propagée envers une partie de la population française.
Si nous sommes d’accord sur ces constats, alors nous devons réagir. Est-ce qu’un seul terme doit nous empêcher de réagir ? Ma réponse est non.
Force est de constater qu’«islamophobie» est aujourd’hui celui le plus communément admis pour définir cette stigmatisation des Français musulmans. Il n’a toujours pas ma préférence mais à partir du moment où il est bien défini ainsi dans le texte, il ne peut pas m’empêcher de signer un appel unitaire – appel tout à fait juste sur le fond.
Je l’ai signé sans renier aucun de mes marqueurs politiques : je peux m’opposer aux lois liberticides que sont la transformation de l’état d’urgence en droit commun ou le projet de loi adopté au Sénat interdisant à des mères voilées d’accompagner des sorties de classe, tout en affirmant mon attachement à la loi de 1905 et à la mise à l’écart de signes d’appartenance religieuse à l’école où étudient des personnes mineures.
S’il n’y avait pas eu cet appel pour une marche le 10 novembre, il n’y aurait eu aucune initiative de rassemblement contre cette forme particulière de racisme. Rien ! Qu’ont proposé ceux qui protestent contre cette initiative pour réagir à la hauteur du danger ? Rien.
Est-ce à dire que lorsqu’il s’agit de défendre des compatriotes musulmans traînés dans la boue et victimes d’attaques par armes à feu, le combat ne mérite plus d’être mené ? Ou seulement au prix d’une pureté politique absolue, ou d’un universalisme abstrait estimant que la lutte contre les discriminations envers les musulmans est la seule qui doit être intégrée dans des luttes plus globales – à savoir «lutter contre le racisme» ? Je ne serais pas de ceux-là, il y va de mon honneur. Je refuse de fermer la porte à la seule initiative politique proposée pour l’heure, en regardant par la fenêtre la haine se déchaîner contre mes concitoyens.
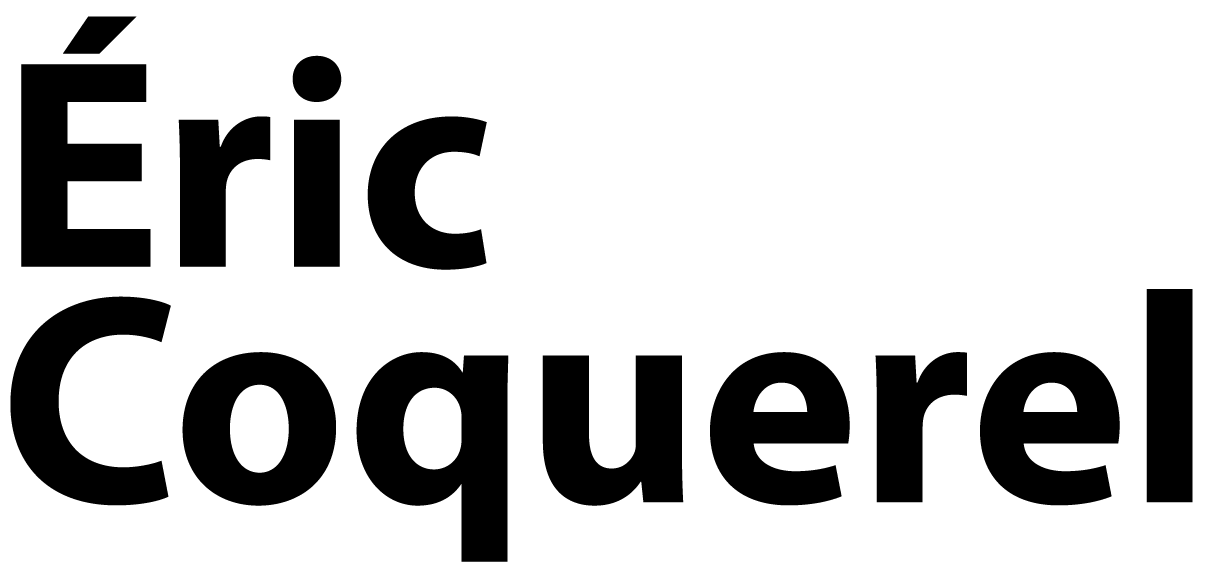

Commentaires récents